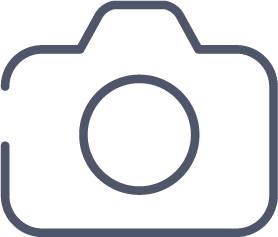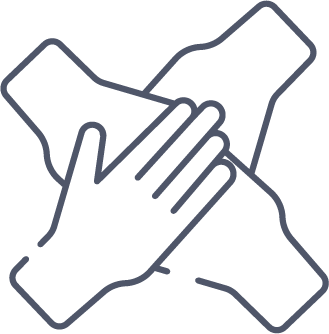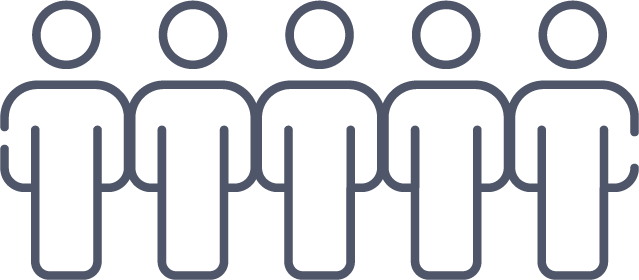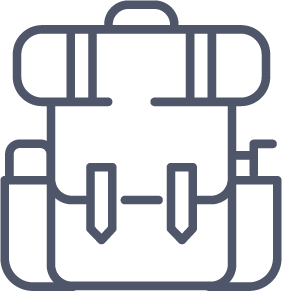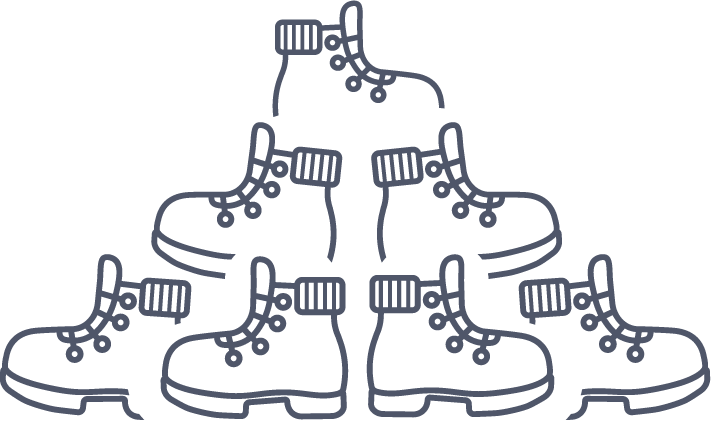Sur les Pas des Huguenots : Genève – Yverdon (Suisse)
 8 jours
8 jours 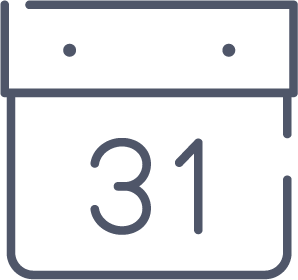 mai
nov
mai
nov
 Soutenu 3
Soutenu 3  Randonnée pédestre
Randonnée pédestre  Liberté
Liberté 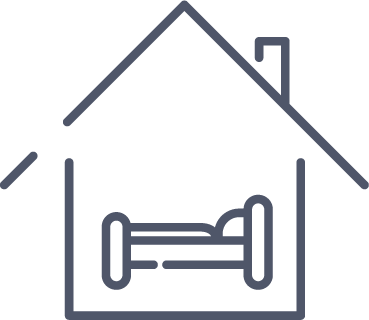 gite ou hôtel simple
gite ou hôtel simple Séjour randonnée itinérante en liberté. Partez 8 jours / 7 nuits en Suisse sur les Pas des Huguenots.
De Genève à Yverdon-les-Bains en passant par Lausanne, Cossonay et Orbe, profitez pleinement des sentiers pédestres face aux Alpes et au massif du Mont Blanc omniprésent dans le paysage.
A partir de Lausanne, le chemin quitte le bord du lac et monte sur le plateau qui permet d’admirer le village médiéval d’Orbe et l’Abbaye de Romainmôtier. La semaine se termine au pied des montagnes du Jura, face aux cimes de l’Oberland.
L’hébergement est prévu en hôtel***, en auberge et en chambres d’hôtes. Pour votre confort le transfert des bagages est assuré par nos soins à chaque étape. Nous vous proposons ce séjour sportif d’avril à novembre.
PROGRAMME
Jour 01 : Genève
Jour 02 : Genève - Bossey (450 m)
Jour 03 : Bossey - Rolle (400 m)
Jour 04 : Rolle - Lausanne (400 m)
Jour 05 : Lausanne - Cossonay (560 m)
Jour 06 : Cossonay - Orbe (500 m)
Jour 07 : Orbe - Yverdon (450 m)
Jour 08 : Yverdon
COMPLEMENT DE PROGRAMME
Les horaires ont été calculés pour un rythme de 300 mètres de dénivelée à l’heure en montée, 500 mètres à l’heure en descente et 4 km à l’heure sur le plat, afin de pouvoir comparer les différentes randonnées avec la même base. Ils ne concernent que la marche effective, tous les temps de repas, de pause ou de contemplation sont à ajouter.
Nous pouvons être amenés à modifier vos étapes si les hébergements prévus sont indisponibles à la période de votre voyage. Les hébergements proposés en remplacement seront de catégorie similaire et leur emplacement aura peu d’incidence sur votre itinéraire. Faites-nous confiance, ces modifications sont toujours faites dans votre intérêt, pour votre sécurité et un meilleur confort !
Nota : Sur l’itinéraire Sur Les Pas des Huguenots, il y a peu d’hébergements et ceux-ci sont de petite capacité. Selon également les jours de fermeture, à certaines étapes, les différents hébergements possibles sont souvent distants de plusieurs kilomètres. La longueur des étapes mentionnée dans cette fiche technique est déterminée en fonction de lieux caractéristiques du chemin et est donc uniquement indicative. Une fois en possession du dossier, vous aurez tous les éléments pour recalculer la longueur effective.
Dates et Prix

Fiche technique
DATES ET PRIX
Merci de nous donner une date de départ avec + ou - 2 jours.
Prix : à partir de 1225 €/personne
Tarif sans transfert de bagages : 995 € / personne
LE PRIX COMPREND
- Les frais d'organisation.
- La nourriture et l'hébergement en demi-pension (sauf diners des jours 01, 03, 05 et 07).
- La fourniture d’un dossier de randonnée complet.
- Le transport des bagages à chaque étape.
Options
Supplément un seul participant (en plus de la chambre individuelle) : + 225 €
Supplément 2eme topoguide : + 30 €
Supplément ½ pension à Genève : + 20 €/personne
Nuit supplémentaire à Genève :
En ½ pension en chambre de 2 : 88 € / personne (Auberge de Jeunesse)
En ½ pension en chambre individuelle : 155 € / personne (Auberge de Jeunesse)
En B&B en chambre de 2 : à partir de 80 € / personne (Hotel ou Auberge de Jeunesse)
En B&B en chambre individuelle : à partir de 130 € / personne (Hotel ou Auberge de Jeunesse)
Nuit supplémentaire à Lausanne :
En ½ pension en chambre de 2 : 105 € / personne (Auberge de Jeunesse)
En ½ pension en chambre individuelle : 155 € / personne (Auberge de Jeunesse)
En B&B en chambre de 2 : à partir de 85 € / personne (Hotel ou Auberge de Jeunesse)
En B&B en chambre individuelle : à partir de 130 € / personne (Hotel ou Auberge de Jeunesse)
Nuit supplémentaire à Yverdon les Bains :
En B&B en chambre de 2 : à partir de 117 € / personne (Hotel)
En B&B en chambre individuelle : à partir de 177 € / personne (Hotel)
Les réservations de prestations supplémentaires doivent se faire à l’inscription et être spécifiées sur le bulletin de réservation.
Modification de Réservation :
ATTENTION ! Des frais de dossier (50 €) pourront être retenus pour tout changement sur la réservation déjà effectuée (type de chambre, date de départ, nombre de personnes…).
Votre randonnée commencée, pour des raisons évidentes d’organisation, vous devez impérativement suivre le programme tel qu’il vous a été confirmé. Il ne sera alors plus possible de modifier vos dates et lieux d’hébergement.
ACCUEIL
Le Jour 01 au premier hébergement à Genève en fin d'après-midi, la veille de votre premier jour de marche.
Si vous arrivez en retard : Pour toute arrivée après 18h30, merci de prévenir votre hébergeur.
Accès train : Gare de Genève Cornavin (TGV Lyria en provenance de Paris notamment). Horaires sur https://www.sbb.ch/fr/horaire.html
Accès bus : Gare de Genève
Nous vous conseillons de comparer le coût et les horaires de différents modes d'accès au point de départ du circuit grâce au site www.comparabus.com. Ce site, pour un même trajet, vous proposera d’autres possibilités telles qu’avion, train, bus ou covoiturage.
Accès voiture : Genève
Itinéraire : www.viamichelin.fr
Parking :
Genève : Parking Cornavin à proximité de la gare et des hébergements : 234 CHF pour 7 jours
Vous pouvez laisser votre véhicule à Yverdon les Bains et rejoindre Genève par le train (1 h 15 - un train toutes les 30 mn). Nombreuses liaisons. Vous récupérez ainsi votre voiture à l'arrivée de la randonnée.
Yverdon : Parking Rives du Lac et parking de la Plage à 10 mn à pied de la gare d’Yverdon : 40 CHF pour 7 jours. Informations https://www.yverdon-les-bains.ch/vie-quotidienne/mobilite/autorisations-de-stationnement
Accès avion : Aéroport Genève Cointrin : www.gva.ch
L'aéroport est relié par train à la gare Genève-Cornavin (centre-ville) et aux autres villes. La gare de l’aéroport est directement accessible depuis les niveaux enregistrement et arrivée : 5 trains par heure aux heures de pointe, 7 mn de trajet.
DISPERSION
Le Jour 08 après le petit déjeuner à Yverdon les Bains.
Retour train : Gare de Yverdon les Bains
Horaires sur https://www.sbb.ch/fr/horaire.html
Gares SNCF proches du Chemin :
Si vous désirez un programme personnalisé :
Gare de Rolle
Gare de Lausanne
Gare de Cossonay
Gare de Orbe
Retour bus : Gare de Yverdon les Bains.
Nous vous conseillons de comparer le coût et les horaires de différents modes d'accès au point de départ du circuit grâce au site www.comparabus.com. Ce site, pour un même trajet, vous proposera d’autres possibilités telles qu’avion, train, bus ou covoiturage.
Retour voiture : Yverdon - Genève par le train (1 h 15 - un train toutes les 30 mn).
Retour avion : Aéroport de Genève Cointrin accessible en train (1 h 25 - un train toutes les 30 mn). Horaires sur https://www.sbb.ch/fr/horaire.html
Hébergement avant ou après la randonnée : Si vous souhaitez prolonger votre séjour, nous pouvons vous réserver une nuit supplémentaire (voir rubrique Dates & Prix).
PORTAGE DES BAGAGES
Bagages transportés par nos soins par véhicule
Nous vous demandons d'avoir un bagage par personne pas trop volumineux (60 cm maximum), dont le poids ne dépasse pas 10 kg.
Nous nous déchargeons absolument de toute responsabilité en cas de détérioration de tout objet fragile (ordinateur portable, par exemple).
Par respect pour les personnes qui transportent vos bagages, pensez que les abords des hébergements peuvent être malaisés (escaliers, etc…), que la place dans les véhicules est limitée et qu'il faut quelquefois parcourir quelques centaines de mètres entre le véhicule et l’hébergement.
Avec un peu d’habitude, votre bagage ne devrait pas dépasser 8 - 10 kg, en effet :
- Les journées sont bien remplies, il est inutile d’amener une bibliothèque.
- Les vêtements mouillés peuvent quasiment sécher tous les soirs à l’hébergement. Il est inutile de prévoir un change complet pour chaque jour.
- Prévoyez une paire de chaussures très légères pour le soir.
- Pour la trousse de toilette, privilégiez l’indispensable, les petites contenances, les échantillons et les kits de voyages. Proscrire les pèse personnes !!!!
Une fois de retour, faites trois tas : ce que vous avez vraiment utilisé, ce que vous avez peu utilisé et ce que vous n’avez pas utilisé. Pour la prochaine randonnée, proscrire le troisième tas et posez-vous la question de la véritable utilité du deuxième.
Nul doute que ces bonnes habitudes vous seront utiles pour vos prochaines randonnées. Ces quelques conseils ont été élaborés grâce à la collaboration d’un groupe de randonneurs et d’hébergeurs.
Si vous faites partie d’un groupe, nous vous demandons d’indiquer sur vos étiquettes bagages le Nom de la personne responsable de ce groupe (personne qui a réservé la randonnée).
Coordonnées de taxi : Vous trouverez dans votre dossier de randonnée les coordonnées des taxis qui transportent vos bagages. Vous pouvez les contacter en cas de blessure, fatigue ou trop longue étape.
Vous pouvez également vous adresser directement aux offices de tourisme des étapes concernées ou aux hébergements.
Nous ne prenons pas en charge la réservation de ces taxis et ils ne sont pas compris dans le prix de la randonnée.
GROUPE
A partir de 1 personne.
NIVEAU
Niveau 3 sur une échelle de 5.
Marcheurs sportifs
Randonnée :
Dénivelée moyenne : 250 m Maximum : 400 m
Longueur moyenne : 23 km Maximum : 27 km
Horaire moyen : 5 h 45 mn Maximum : 6 h 30 mn
Orientation :
Vous devez être capable de suivre un itinéraire en vous servant d'une carte, d'un carnet de randonnée rédigé par nos soins et des indices sur le terrain. Vous n’empruntez que des itinéraires balisés. Sur demande, nous pouvons vous faire parvenir les traces GPS du parcours.
Cet itinéraire s'effectue sans accompagnateur et sous votre propre responsabilité. Nous vous fournissons toutes les indications et la logistique nécessaires au bon déroulement de votre randonnée. Vous devez être capable d’autonomie en jugeant de vos forces et en appréciant des situations inattendues (fatigue, météo, présence d’animaux, modification du terrain, etc…).
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreur de votre part concernant l'orientation (erreur ou changement d’itinéraire) ou la gestion du temps (départ trop tardif le matin, pause pique-nique trop longue…).
TRANSFERTS INTERNES
Aucun transfert. Tous les trajets sont effectués à pied, sauf si vous utilisez les transports en commun. Chaque étape peut être effectuée ou raccourcie en prenant le train.
DOSSIER DE RANDONNEE
Trois semaines environ avant votre départ, vous recevrez le dossier complet comprenant tous les éléments nécessaires à la réalisation de votre randonnée
Un dossier est fourni par groupe de 2 à 5 personnes. Si vous désirez des dossiers supplémentaires, ceux-ci sont à réserver à l’inscription (avec supplément).
Ce dossier comprend :
- Un topo guide rédigé par nos soins,
- Quatre cartes 1/50 000 avec itinéraire surligné (à nous rendre en fin de séjour)
- Une feuille de route avec la liste des hébergements ainsi que toutes les informations complémentaires.
Nous proposons également un carnet de route dématérialisé grâce à une application à télécharger sur votre Smartphone. En utilisant le GPS de votre téléphone cette application propose un guidage vocal et/ou visuel (flèches de direction).
HEBERGEMENT
Hébergement en hôtels ***, auberges et chambres d’hôtes en chambre de 2 avec salle de bains.
Le cout de la vie en Suisse est plus élevé qu’en France, donc nous avons alterné le type d’hébergements pour proposer un tarif cohérent. Plusieurs hôtels n’ont pas de restaurant et ne proposent pas la ½ pension.
Voici le détail :
Jour 01 : Hotel ou Auberge de Jeunesse moderne et confortable à Genève (nuit et petit déjeuner). Possibilité de ½ pension si hébergement en Auberge de Jeunesse (+ 15 €/personne).
Jour 02 : Hotel à Bossey (1/2 pension).
Jour 03 : Chambres d’Hôtes ou Hotel à Rolle (nuit et petit déjeuner).
Jour 04 : Auberge de Jeunesse moderne et confortable à Lausanne (1/2 pension).
Jour 05 : Hotel à Cossonay (nuit et petit déjeuner).
Jour 06 : Hotel à Orbe(1/2 pension).
Jour 07 : Chambres d’Hôtes ou Hotel à Yverdon (nuit et petit déjeuner).
Pour les étapes sans diner (Genève, Rolle, Cossonay et Yverdon) votre hébergeur vous proposera une sélection de restaurants à proximité.
Par respect pour la période de repos journalière des hébergeurs (disponibles tôt le matin et tard le soir), les chambres ne sont pas disponibles avant 16 heures.
Supplément pour chambre individuelle.
Si vous désirez une chambre à 3 lits, il faut savoir que peu d’hébergements en sont équipés. Le troisième lit peut être un lit d’appoint, un lit d’enfant ou un canapé convertible. Pour les étapes où ce ne sera pas possible, un supplément par nuit pour chambre individuelle vous sera facturé.
Lorsqu’un hébergement est indisponible, nous pouvons être amenés à vous faire passer 2 nuits dans le même hébergement et organiser un transfert ou changer de catégorie d’hébergement (ce qui ne change en rien le contenu de votre randonnée mais peut occasionner un supplément pour lequel nous vous demandons votre accord). Les modifications de programme vous sont indiquées sur votre confirmation de réservation.
Repas : Les dîners sont l'occasion de goûter aux spécialités locales. Ils sont en général servis à partir de 19 h 30 et sont composés la plupart du temps du menu du jour (pas de choix de menu).
Pour les étapes sans diner (Genève, Rolle, Cossonay et Yverdon) votre hébergeur vous proposera une sélection de restaurants à proximité.
Les petits déjeuners sont traditionnels (parfois sous forme de buffet) et sont servis à partir de 8 h - 8 h 30. Si vous désirez prendre votre petit déjeuner plus tôt, voir avec votre hébergeur la veille si cela est possible.
Pique-nique :
La formule de base de ce séjour est en demi-pension.
Vous vous chargez vous-même de vos pique-niques. Il est toujours possible d'acheter un pique-nique (à votre charge) dans les hébergements. Il suffit de le réserver de préférence l’avant-veille. Il existe de nombreuses possibilités de se ravitailler dans les villages traversés.