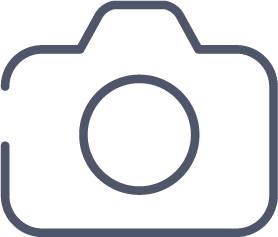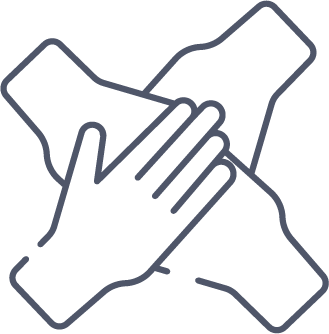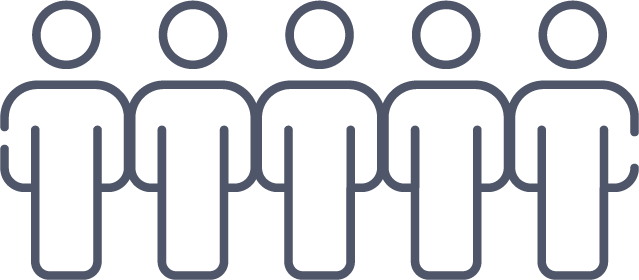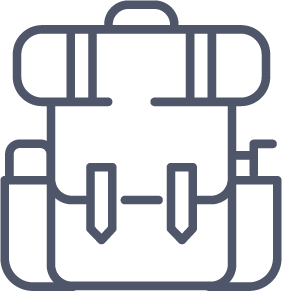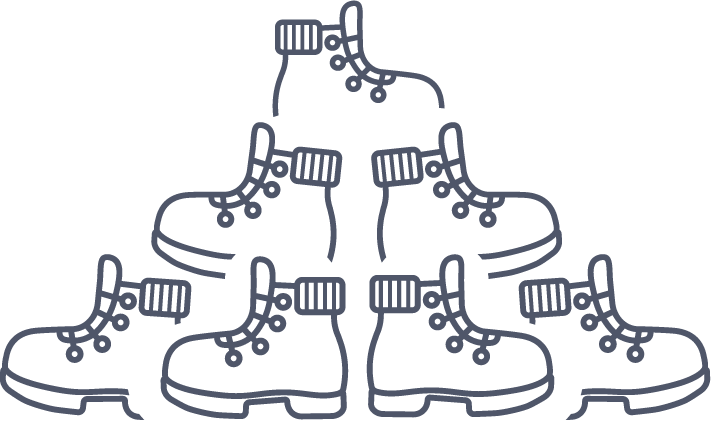Sur les pas des Huguenots : Chambéry – Genève
 7 jours
7 jours 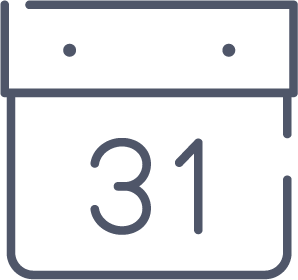 oct
oct
 Soutenu 3
Soutenu 3  Randonnée pédestre
Randonnée pédestre  Liberté
Liberté En 1685, le roi Louis XIV révoque l’Edit de Nantes et un climat de persécution s’installe en France. 200 000 « Huguenots » cherchent alors refuge sur des terres protestantes en Europe et dans le monde. Dans le Sud-Est du Royaume de France, la Réforme est très présente. Depuis le Dauphiné, les Cévennes et le Luberon les départs sont nombreux vers Genève, puis vers l’Allemagne où ils sont accueillis et peuvent fonder des colonies. Tout au long de ses 2000 km, le sentier international « Sur les Pas des Huguenots » suit au plus près le tracé historique de cet l’exil. Au départ du Poët Laval (Drôme), le cheminement dominant passe par Genève, traverse la Suisse, les « Land » du Bade-Wurtemberg et de la Hesse jusqu’à Bad Karlshafen. Source : www.surlespasdeshuguenots.eu Cette étape relie l’ancienne capitale du Duché de Savoie à Genève, haut-lieu du protestantisme. Votre randonnée se déroulera sous le signe de l’eau, car après avoir longé le Lac du Bourget, plus grand lac de France, vous dominerez la vallée du Rhône avant de terminer au bord du Lac Léman. Il y a plus de 500 ans, Genève fut une ville refuge pour des milliers d’exilés venus de France et marqua la fin de leurs persécutions. La visite de la « Rome protestante » est incontournable après le parcours français.
PROGRAMME
Jour 01 : Chambéry
Arrivée à Chambéry (268 m) en fin d’après-midi. Vous prendrez votre dîner dans un restaurant de la ville ancienne.
Jour 02 : Chambéry - Aix Les Bains (241 m)
Jour 03 : Aix Les Bains - Chindrieux (310 m)
Jour 04 : Chindrieux - Seyssel (254 m)
Jour 05 : Seyssel - Chaumont (606 m)
Jour 06 : Chaumont - St Julien en Genevois (460 m)
Jour 07 : St Julien en Genevois - Genève (400 m)
COMPLEMENT DE PROGRAMME
Les horaires ont été calculés pour un rythme de 300 mètres de dénivelée à l’heure en montée, 500 mètres à l’heure en descente et 4 km à l’heure sur le plat, afin de pouvoir comparer les différentes randonnées avec la même base. Ils ne concernent que la marche effective, tous les temps de repas, de pause ou de contemplation sont à ajouter.
Nous pouvons être amenés à modifier vos étapes si les hébergements prévus sont indisponibles à la période de votre voyage. Les hébergements proposés en remplacement seront de catégorie similaire et leur emplacement aura peu d’incidence sur votre itinéraire. Faites-nous confiance, ces modifications sont toujours faites dans votre intérêt, pour votre sécurité et un meilleur confort !
Nota : Sur l’itinéraire Sur Les Pas des Huguenots, il y a peu d’hébergements et ceux-ci sont de petite capacité. Selon également les jours de fermeture, à certaines étapes, les différents hébergements possibles sont souvent distants de plusieurs kilomètres. La longueur des étapes mentionnée dans cette fiche technique est déterminée en fonction de lieux caractéristiques du chemin et est donc uniquement indicative. Une fois en possession du dossier, vous aurez tous les éléments pour recalculer la longueur effective.
NIVEAU
Niveau 3 sur une échelle de 5.
Marcheurs sportifs
Randonnée :
Dénivelée moyenne : 440 m Maximum : 730 m
Longueur moyenne : 19 km Maximum : 26 km
Horaire moyen : 5 h 15 mn Maximum : 6 h 30 mn
Orientation : Sur demande, nous pouvons vous faire parvenir les traces GPS du parcours.
Pour la France :
Niveau 1 : Un peu d’attention et quelques notions de lecture de carte sont nécessaires.
Vous devez être capable de suivre un itinéraire en vous servant d'un topoguide FFRP et des indices sur le terrain. Vous n’empruntez que des itinéraires balisés.
Pour la Suisse :
Niveau 2 : Attention et lecture de carte correcte.
Vous devez être capable de suivre un itinéraire en vous servant d'une carte, d'un carnet de randonnée rédigé par nos soins et des indices sur le terrain. Vous n’empruntez que des itinéraires balisés.
Cet itinéraire s'effectue sans accompagnateur et sous votre propre responsabilité. Nous vous fournissons toutes les indications et la logistique nécessaires au bon déroulement de votre randonnée. Vous devez être capable d’autonomie en jugeant de vos forces et en appréciant des situations inattendues (fatigue, météo, présence d’animaux, modification du terrain, etc…).
Il vous appartient de vous renseigner auprès des Offices du tourisme de l’évolution météorologique (bulletins affichés) ou d’appeler le répondeur météo au 08 99 71 02 + numéro du département : Exemple 08 99 71 02 73 pour la Savoie.
Nous tenons à vous mettre en garde sur l’efficacité du téléphone portable en milieu montagnard. En effet, si les villages sont généralement couverts par les réseaux de téléphonie mobile (selon l’opérateur), sachez que de très nombreuses zones d’ombre subsistent et que votre appareil s’avérera souvent inutile de longues heures dans la journée. Si toutefois un réseau est présent, en cas de besoin de secours, vous pouvez composer le 112 qui est le numéro d’appel d’urgence prioritaire.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreur de votre part concernant l'orientation (erreur ou changement d’itinéraire) ou la gestion du temps (départ trop tardif le matin, pause pique-nique trop longue…).
LE PRIX COMPREND
- Les frais d'organisation.
- La nourriture et l'hébergement en demi-pension (sauf jour 6 en B&B).
- La fourniture d’un dossier de randonnée complet.
- La fourniture du topo guide FFRP.
- Le transport des bagages à chaque étape.
À quoi s'attendre

Carte